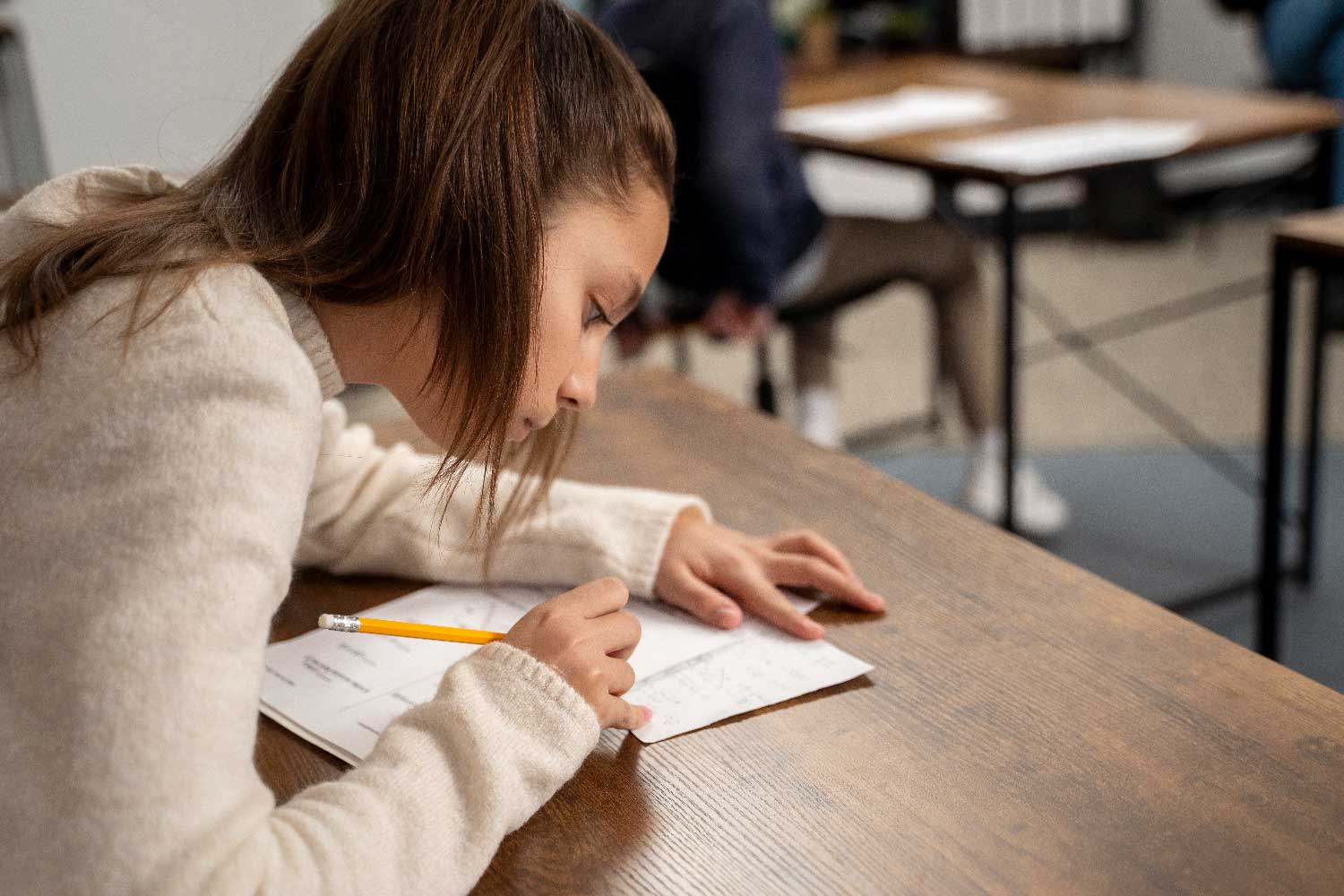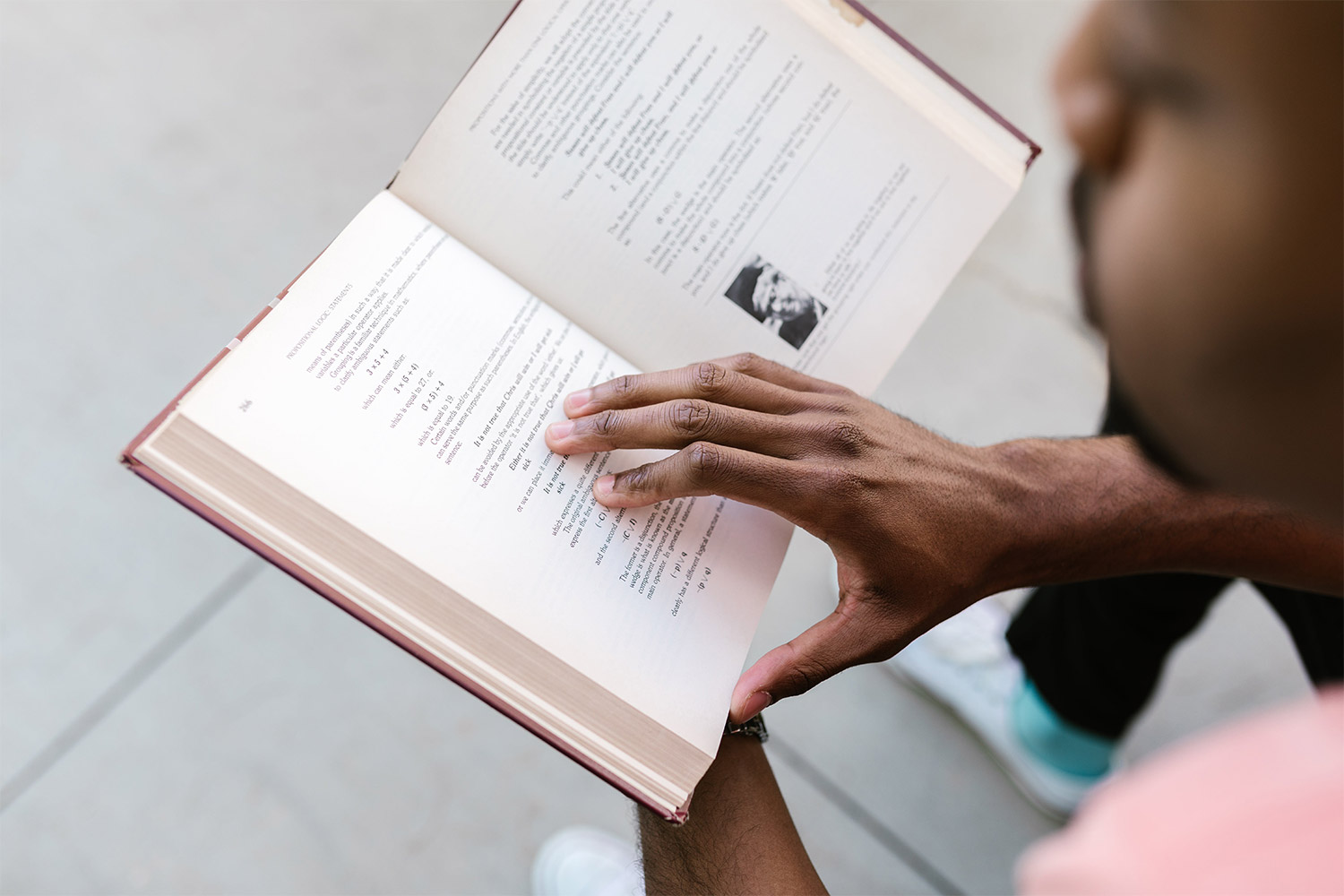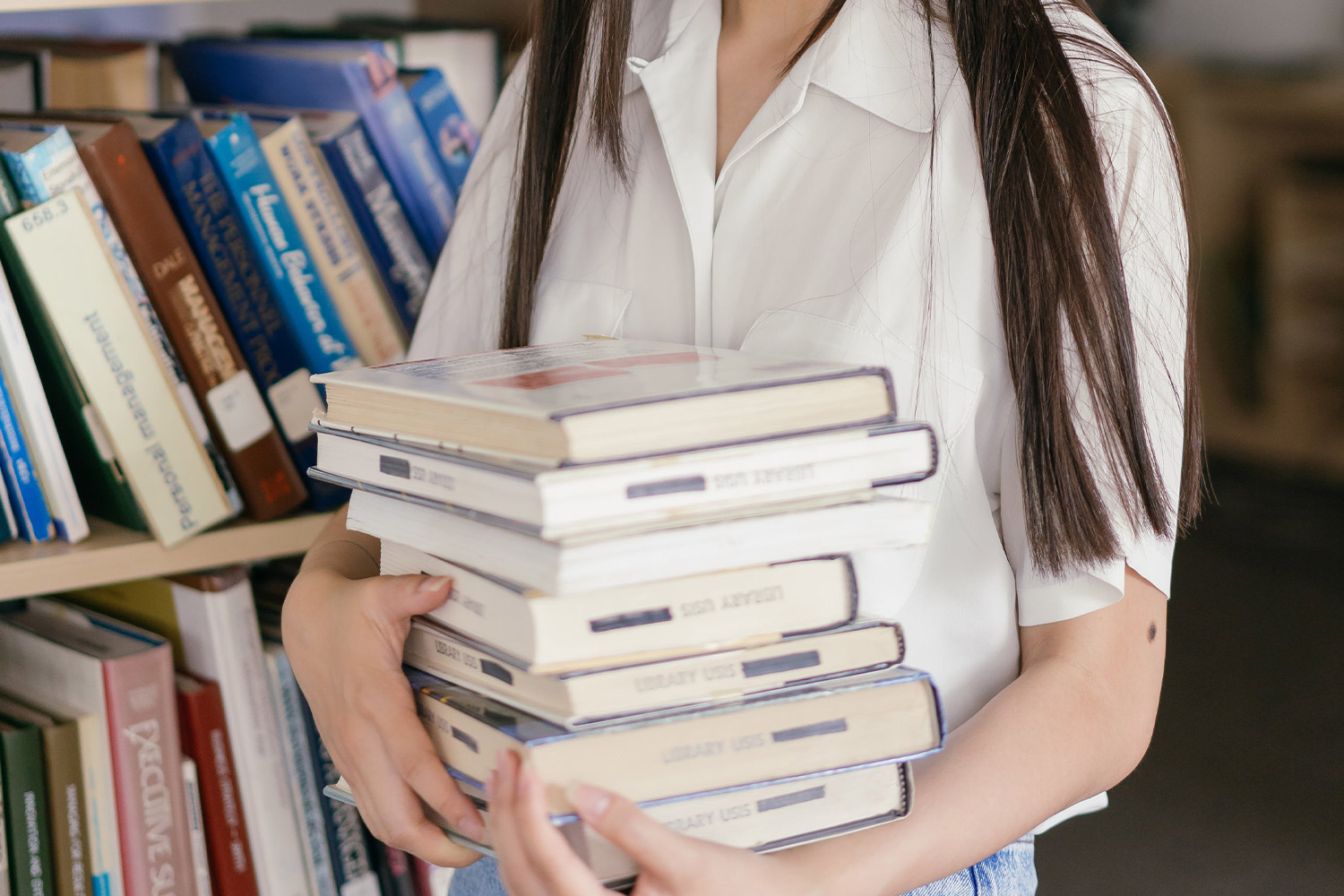Combien de moyenne pour avoir le bac en contrôle continu ?
La réforme du bac a engendré de nombreux changements, tant pour les programmes d’enseignement que pour la validation du diplôme. Outre l’abandon des filières au profit des spécialités, le système de notation du bac a évolué. Les élèves sont évalués en fin de terminale par les épreuves finales, mais également